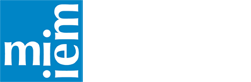Concept
Handicap, pauvreté et travail au Moyen Âge
Les études sur ce que la langue française appelle le handicap ont véritablement émergé, pour la période médiévale, au tournant de notre siècle. Elles sont désormais bien représentées, autant dans les sciences historiques qu’en philologie et littérature, surtout dans le monde anglo-saxon, mais aussi dans une moindre mesure en Allemagne et ailleurs, moins dans la sphère universitaire francophone.
Pourtant, les personnes en situation de handicap étaient apparues plus tôt dans le champ des recherches universitaires : dans les études sur la pauvreté. En effet, ces grandes études des années 1960 aux années 1990, comme celles de Michel Mollat ou de Bronislaw Geremek, sont souvent rapidement parties du principe que handicap et pauvreté étaient inextricablement liés. Les infirmi, disent leurs autrices et auteurs, ne pouvaient pas travailler du fait du grand âge ou d’un handicap, et cette inaptitude au travail conduisait forcément à la pauvreté. En même temps, les travaux sur la pauvreté au Moyen Âge présentent les personnes handicapées comme les bons pauvres par excellence, ceux qui pouvaient légitimement prétendre à la charité, à l’inverse des mendicantes validi qui profitaient de la société par paresse ou vice. Ainsi, malgré quelques recherches plus nuancées, une image forte de la personne handicapée mendiante s’est imposée, qui n’a pas été remise en question depuis lors.
Il est vrai que l’iconographie médiévale invite à de tels raccourcis, tant la façon la plus commode de présenter graphiquement une personne pauvre était alors, en plus de l’habiller de haillons et de lui faire tendre la main, était alors le handicap visible et les objets qui lui sont liés, béquilles ou jambes de bois. Par ailleurs, les sources historiques les plus abondantes, comme l’hagiographie d’une part, les actes de la pratique issues des gouvernements urbains, et les documents hérités des institutions de charité, semblent associer presque automatiquement handicap et pauvreté.
L’Institut d’Études Médiévales de l’université de Fribourg organise, du 3 au 5 septembre 2025, un colloque international et interdisciplinaire sur le sujet « Handicap, pauvreté et travail au Moyen Âge », pour réinterroger cette automaticité. En effet, les catégories qui sont ici liées sont problématiques, puisque la catégorie de « handicap » (ou « disability », Behinderung »/« Beeinträchtigung », disabilità) n’existe pas, tandis que « pauvreté » et même « travail » sont très polysémiques et doivent également être historicisés.
Il s’agira donc de mobiliser des disciplines différentes, histoire, histoire de l’art, histoire du droit, littératures de différentes langues, théologie, philosophie, archéologie, pour réfléchir sur les liens entre « handicap », pauvreté et travail, en recourant à des sources et matériaux divers (littéraires, iconographiques, sources normatives et de la pratique). Ces journées seront l’occasion de réfléchir ensemble à des questions telles que celle de la présence de personnes handicapées n’apparaissant dans les sources ni comme pauvres, ni comme inactives ; de l’acceptation sociale de leur inactivité, ou encore celle des expériences diverses du travail ou de son absence selon le statut social, mais aussi le genre de la personne handicapée.