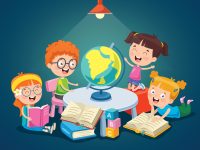Comme tous les glaciers du monde, ceux d’Asie centrale se voient menacés par le réchauffement climatique. Martina Barandun, du Département des géosciences de l’Université de Fribourg, se rend chaque année à leur chevet pour comprendre les processus en cours. Avec le soutien de sa collègue Anouk Volery, elle s’engage aussi corps et âme pour former la relève scientifique locale.
Souvenez-vous du 28 mai dernier. En s’effondrant, un glacier venait de raser le village de Blatten dans le Lötschental. Immédiatement, le standard du service de communication de l’Université de Fribourg s’est mis à crépiter: les journalistes souhaitaient à tout prix interviewer un·e expert·e capable d’expliquer les causes de la catastrophe et ses liens éventuels avec le dérèglement climatique. Date de l’interview: aussi vite que possible, et aussi rapidement que nécessaire. Misère! Martina Barandun, chercheuse en géosciences, aurait parfaitement fait l’affaire, mais elle se trouvait sur le terrain en Asie centrale, à plus de 4 000 kilomètres de la Suisse. Trop tard pour les journalistes, mais — c’est bien connu — le malheur des uns fait le bonheur des autres! Nous lui avons laissé le temps de rentrer au pays, de défaire ses valises, de reprendre son souffle, puis de nous parler de sa dernière expédition dans cette splendide région où tous les pays se terminent en -istan.
Une histoire post-soviétique
L’histoire d’amour que Martina Barandun a tissée avec l’Asie centrale remonte à 2012. Considérée comme le troisième pôle de la planète, la région abrite des glaciers dont l’étendue ridiculise nos plus beaux spécimens alpins. Un véritable paradis pour les spécialistes de la cryosphère! Pour vous faire une idée, le glacier Fedchenko (récemment rebaptisé Vanch-Yakh) atteint 77 kilomètres de longueur, soit presque quatre fois celle du glacier d’Aletsch, le plus grand des Alpes.
À l’instar des habitants du bloc soviétique, les glaciers y étaient étroitement surveillés depuis les années 1950, mais l’effondrement de l’URSS est venu tout chambouler. «Il faut se rendre compte que la recherche y était très avancée. Les scientifiques soviétiques avaient installé des stations de monitoring à proximité des glaciers et y travaillaient toute l’année», explique Martina Barandun. «Faute d’argent, suite à l’effondrement du système en 1991, la majeure partie de ces recherches ont été abandonnées. Maintenant, il existe un hiatus de données de près de deux décennies que nous avons pour ambition de combler.»
Reprise des mesures
Débuté au Kirghizstan en 2011, ce projet consiste à remettre sur pied un réseau de monitorage des glaciers. «On dit en général que 30 années de mesures sont nécessaires pour obtenir des données solides sur l’évolution climatique», précise la chercheuse de l’Université de Fribourg. Concrètement, les scientifiques grimpent dans la zone haute des glaciers à la fin de l’été et y mesurent la hauteur de la neige et sa densité. L’ablation des glaciers, quant à elle, se mesure sur la langue, là où la glace est exposée.
Combinées avec les données de stations météorologiques situées à proximité des glaciers, ces informations permettent d’étudier les liens qui existent entre l’évolution de diverses variables météorologiques, dont la température, et les fluctuations glaciaires.
Entretien indispensable
Cependant, au-dessus de 3 000 mètres d’altitude, les tempêtes et le climat extrême éprouvent durement les instruments installés par les glaciologues de l’Université de Fribourg. Ce printemps, Anouk Volery, chercheuse junior et collègue de Martina Barandun, est allée effectuer des travaux de maintenance avec un technicien local. Elle en a également profité pour étoffer leur réseau de deux nouvelles stations météorologiques sur des hauts plateaux près du lac Issyk-Kul. «Nous souhaitons connaître les quantités de précipitations dans cette région, mais les mesures à ces altitudes s’avèrent difficiles et les précipitations très variables d’un endroit à l’autre», observe Anouk Volery.
À côté de ses travaux d’entretien, Anouk Volery cherche à mieux saisir le rôle des précipitations sur l’albédo de la glace, soit la capacité d’une surface à réfléchir la lumière. «S’il y a une bonne couverture de neige, bien blanche, le glacier va moins absorber l’énergie solaire et davantage réfléchir les rayons du soleil. En revanche, si la neige fond de manière prématurée, la glace sous-jacente, dont la couleur est plus sombre, absorbera davantage l’énergie solaire accélérant ainsi le processus de fonte. C’est un cercle vicieux!»
Réchauffement perceptible à vue d’oeil
Martina Barandun, qui fréquente la région depuis plus d’une décennie, a pu observer des phénomènes tout à fait inhabituels, notamment l’année dernière: «Pour la première fois, j’ai vu de la pluie à plus de 4 000 mètres d’altitude», se souvient-elle, encore choquée. Elle en est aussi convaincue: «2025 sera une très mauvaise année pour les glaciers d’Asie centrale. La neige s’est faite rare cet hiver et les glaciers ont commencé à fondre fin mai, soit deux mois plus tôt que la norme. Les glaciers vont perdre beaucoup de masse».
Impacts sur la société
Les deux spécialistes de la cryosphère n’étudient pas les glaciers uniquement pour la beauté de la science. De leur évolution dépend le sort d’une population nombreuse, en particulier en Asie centrale, région très sèche. «Les communautés locales tirent leur eau potable des glaciers, pour l’énergie et l’irrigation de leurs cultures», énumère Anouk Volery.
«À l’avenir, il y aura moins d’eau, surtout en été, complète Martina Barandun, notamment pour le coton et le riz. Nos études montrent qu’il faut améliorer les systèmes d’irrigation qui, pour la plupart, datent de l’époque soviétique, voire même opter pour des cultures moins gourmandes en eau.»
Faire fondre les préjugés sexistes
Mais l’un des volets les plus chers au coeur de nos deux chercheuses, c’est la formation d’une relève scientifique locale, en particulier féminine. Dès ses premières expéditions, Martina Barandun a remarqué que les chercheuses étaient rares. «J’ai très vite compris que ce n’était pas parce qu’il n’y en avait pas, mais tout simplement parce que leur entourage, académique et familial, les décourageait.» Deux raisons à cela. La première: les femmes ne seraient pas faites pour se balader en haute montagne. La seconde: pourquoi former des personnes qui finiront par se marier et renoncer à leur carrière académique?
En 2019, Martina Barandun décide de lancer Adventure of Science. Chaque année, avec le soutien de collègues d’Asie centrale et d’Europe, elle met sur pied une expédition exclusivement réservée aux femmes au glacier Golubin, à plus de 3 200 m d’altitude. Des instructrices leur dispensent des modules de glaciologie, d’hydrologie, de climat, et abordent également la question de la place des femmes dans la société.
Confrontées à un environnement hostile, les participantes doivent aussi apprendre à camper dans le froid, chercher les sources d’eau, etc. «Nous souhaitons leur donner confiance, leur procurer un sentiment de liberté et les aider à sortir de leur zone de confort, afin de leur montrer qu’elles sont capables de faire bien plus que ce qu’elles ne pensent!», résume Martina Barandun.
Le concept est un succès immédiat dès la première édition: alors que le camp ne peut accueillir que 10 participantes, plus d’une centaine se pressent au portillon. A chaque édition, le groupe est composé de deux Kirghizes, deux Ouzbèkes, deux Kazakhes, deux Tadjikes et deux Turkmènes. Les profils sont eux aussi très variés: il y a des cuisinières, des journalistes, des artistes, des étudiantes en sciences de l’environnement et en économie. «Nous cherchons cette diversité, non seulement au sein des participantes, mais aussi des instructrices. Cela donne un mélange intéressant», sourit Anouk Volery.
Exposition à Douchanbé
Lors de la dernière expédition, et tandis qu’Anouk Voléry vérifiait les stations météorologiques au Kirghisztan, Martina Barandun participait à une exposition sur la cryosphère à Douchanbé, capitale du Tadjikistan. «En Suisse, nous entretenons une relation étroite avec nos montagnes. Nous y randonnons et y skions. Ce n’est pas le cas en Asie centrale. Nous avons donc organisé plusieurs stands pour que les enfants puissent mener des expériences sur le pergélisol et les glaciers, explique Martina Barandun. La population commence seulement maintenant à réaliser les effets du réchauffement climatique.»
Bonne nouvelle toutefois! Ce travail de vulgarisation et de formation de la relève, entrepris il y a plus d’une décennie par Martina Barandun et ses collègues, commence à porter ses fruits. «Dans la région, en 2012, il n’y avait encore personne sur qui nous pouvions nous appuyer. Aujourd’hui, il existe sur place des scientifiques et des technicien·ne·s très compétent·e·s!» La preuve que la foi – et surtout l’amour des gens – peuvent déplacer des montagnes, à défaut de ralentir la fonte des glaciers.
- Martina Barandun
- Anouk Volery
- Adventure of Science: Women and glaciers in Central Asia
- Photos: Anouk Volery et Martina Barandun
- Human-IST, 10 ans à réconcilier l’humain et la machine - 27.01.2026
- Plaidoyer pour une histoire polyphonique - 17.12.2025
- Andrographis paniculata: un complément prisé, mais pas sans risques - 15.12.2025