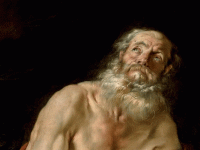De nombreux pays du monde, dont les Philippines, voient d’un mauvais œil la présence des futurs pères en salle d’accouchement. En Occident, la participation des papas à la naissance paraît à l’inverse évidente. Il y a quelques décennies encore, il en allait tout autrement.
Stéphanie Roth vit aux Philippines depuis une quinzaine d’années, où elle est mariée à un homme indigène. En 2008, lorsqu’elle est tombée enceinte pour la première fois, cette Valaisanne a décidé qu’elle irait accoucher en Suisse. Quelques mois plus tard, la voilà installée en salle de travail à l’hôpital de Sion, le visage tendu par la douleur des contractions. A ses côtés, une de ses amies lui tient la main et tente de l’apaiser. Le futur papa, lui, fait les cent pas dans les couloirs de la maternité.
«Aux Philippines, l’accouchement est une affaire de femmes», explique Stéphanie Roth. «Dans les hôpitaux publics, les hommes sont carrément interdits en salle de travail», précise-t-elle. «Pour mon mari, il était donc impensable d’assister à la naissance de notre fils, même si en Suisse, il y aurait été autorisé.» De nombreux autres pays à travers le monde appliquent la même règle qu’aux Philippines, de façon plus ou moins stricte. «Certaines cliniques privées philippines sont plus souples en la matière que les hôpitaux publics», précise l’expatriée valaisanne.
En Occident, c’est la réalité inverse qui prédomine: non seulement les futurs pères sont admis en salle de travail, mais ils sont vivement encouragés à assister à la naissance. Au point que leur présence est souvent perçue comme une évidence. «J’ai eu droit à pas mal de coups d’œil surpris à la maternité lorsque j’ai annoncé que mon mari resterait dans le couloir durant le travail», confirme Stéphanie Roth. Les chiffres sont parlants: en France, trois quarts des géniteurs sont les témoins des premiers cris de leur enfant, selon un décompte portant sur l’année 2003. En Italie, la participation des hommes aux accouchements naturels atteignait carrément 94% dans les années 2000, d’après une autre étude.
Police et amendes
Dans ces conditions, difficile d’imaginer qu’il y a quelques décennies encore, les naissances occidentales se déroulaient dans un contexte radicalement différent, où les futurs papas étaient considérés – au mieux – comme des nuisances en salle d’accouchement. Au pire, ils en étaient exclus. L’historienne Andrée Rivard, auteure du livre «De la naissance des pères», rapporte qu’en Amérique du Nord, dans les années 1960, le personnel hospitalier menaçait parfois d’appeler la police si le conjoint ne quittait pas le chevet de la parturiente. Quant à l’Association médicale américaine, elle relate une amende de 150 dollars infligée en 1965 à un père ayant fait fi de l’interdiction d’entrer en salle de travail.
Plus récemment encore, dans les années 1970, un hôpital de Montréal qui laissait une «trop» grande place aux pères s’est vu contraint de fermer sa maternité. Cette sanction n’est néanmoins pas restée sans réactions: des lettres de protestation ont été envoyées à la presse et des manifestations ont été organisées dans les rues de la ville canadienne. Selon Andrée Rivard, on s’est alors vu obligé d’assouplir les règles dans les hôpitaux par peur de perdre des patientes. Le vent était en train de tourner.
Gynécos tout-puissants
Petit retour en arrière en compagnie de Caroline Rusterholz, professeure au Département d’histoire contemporaine de l’Université de Fribourg et spécialiste de l’histoire sociale de la médecine, de la santé sexuelle et de la famille. «Jusqu’au début du 20e siècle, les accouchements avaient lieu à la maison en Occident. Les hommes y jouaient une part active, par exemple en faisant bouillir de l’eau. Par contre, ils n’entraient généralement pas dans la pièce où se déroulait le travail.»
La médicalisation des naissances va entraîner, par vagues successives, des mutations dans la répartition des rôles des mères, des pères et aussi des soignant·e·s. «Longtemps, l’hôpital a été considéré comme un lieu de mort, dans lequel seules les femmes pauvres venaient accoucher en cas de complications», poursuit Caroline Rusterholz. A partir des années 1950, renversement de vapeur: les accouchements à l’hôpital se généralisent, ce qui va entraîner une remise en question de la présence des pères.
Selon l’historienne et auteure Andrée Rivard, de nombreux médecins craignaient d’être jugés par les conjoints des futures mères et de perdre de leur autorité. Vient s’ajouter à cela le fait qu’à partir des années 1960, les patientes sont de plus en plus souvent médicamentées et anesthésiées – donc partiellement ou totalement inconscientes – durant le travail, rendant le soutien des papas moins évident, qu’il soit pratique ou psychologique. Plus tard, dans les années 1980, des voix critiques se sont d’ailleurs élevées pour dénoncer une appropriation par les gynécologues de la gestion de l’accouchement, les parents – parturiente y compris – se retrouvant dans un rôle de spectateurs·trices.
Des papas plus impliqués
Comme mentionné précédemment, l’exclusion des pères de la sphère de l’accouchement en milieu hospitalier va être remise en question. «Différentes évolutions sociétales expliquent cela», analyse Caroline Rusterholz. La professeure de l’Université de Fribourg cite notamment le développement (dans les années 1950-1960) des techniques dites «sans douleur», faisant la part belle à la préparation de l’accouchement et dans lesquelles les hommes jouent un rôle important.
De façon plus large, cette époque marque la sortie des pères du rôle de pourvoyeurs purs. «Ils se mettent à jouer davantage avec les enfants, à passer plus de temps en famille», souligne l’historienne. La diffusion de la théorie psychologique de l’attachement – qui met l’accent sur l’importance des relations proches d’un enfant dans son développement émotionnel et social – appuie cette évolution.
La démocratisation de la pilule contraceptive joue elle aussi un rôle. «Elle entraîne une réduction du nombre d’enfants par ménage et érige dans la foulée la famille nucléaire en modèle.» Il ne faut pas oublier non plus l’engagement accru des femmes sur le marché de l’emploi, qui rend le soutien de leurs conjoints nécessaire à la maison. Dans ce contexte, on observe «une augmentation progressive de l’implication des papas dans tous les domaines, y compris en ce qui concerne la grossesse et l’accouchement».
En forte hausse ces dernières années, les accouchements en maison de naissance intègrent d’ailleurs complètement les pères, selon Caroline Rusterholz. Quant au métier de doula, c’est-à-dire d’accompagnante (non-médicale) de la grossesse et de l’accouchement, il se décline désormais au masculin (doulo) et vise spécifiquement les pères.
Attention aux discriminations
A l’époque contemporaine, la présence des futurs papas en salle d’accouchement semble être devenue une évidence en Occident, ce que confirment les chiffres rapportés plus haut. Tellement évidente qu’elle fait parfois débat. Quid en effet des hommes qui n’ont pas envie d’assister à la naissance de leur enfant et se forcent à le faire, faute d’être perçus par leur entourage et/ou par les soignant·e·s comme des «mauvais pères»? Quid encore des mères célibataires ou des couples lesbiens, que cette accentuation d’un modèle de couple hétéronormatif tend à discriminer?
Lorsqu’elle est à nouveau tombée enceinte quelques années plus tard, Stéphanie Roth a choisi cette fois-ci d’accoucher aux Philippines. Pas à l’hôpital mais à domicile, accompagnée par une sage-femme, une amie et une voisine mère de huit enfants. «Quand le travail a commencé, la sage-femme a ordonné à mon mari et à mon fils, qui tournaient comme des hélices dans la maison, d’aller faire un tour à la plage», raconte-t-elle avec un clin d’œil. «Ils n’ont été autorisés à revenir qu’après la naissance du bébé.»
_________- Une recherche haute en couleurs - 12.12.2025
- Les bactéries font (toujours) de la résistance - 18.11.2025
- «Il faut de tout pour faire la science» - 30.10.2025