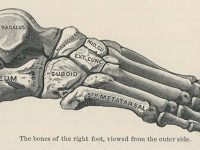La Faculté des lettres décerne le titre de docteur honoris causa à Donatella Zari et Carlo Giantomassi. Collègues et conjoints, les deux historiens de l’art n’hésitent pas à se rendre dans des zones à risque pour sauvegarder le patrimoine de l’humanité.
Doctor Honoris Causa de l’Université de Fribourg… Comment vivez-vous ce moment?
Donatella Zari: Nous ne nous attendions pas à un tel honneur! Notre seule question a été: pourquoi nous? C’est à la fois une surprise et une première.
Carlo Giantomassi: Notre unique lien avec l’Université de Fribourg est le Professeur Michele Bacci, que nous avons rencontré à Pise, lors d’un congrès. Nous apprécions d’autant plus cette distinction que nous n’avions pas conscience que nos travaux avaient une résonance internationale.
Quelle est votre formation?
CG: A quelques années d’intervalle, nous avons tous deux fréquenté l’Istituto Centrale del Restauro à Rome. Nous y avons suivi un cursus d’historien de l’art et appris les métiers de conservateur et de restaurateur. Nous sommes spécialisés dans les peintures.
DZ: Nous nous occupons également de mosaïques, de statues et de bâtiments, comme l’Arche de Constantin à Rome. A l’époque, les études étaient beaucoup plus généralistes, dans le bon sens du terme. Nous étions capables de travailler sur toutes sortes de supports et cela s’est révélé très utile à l’étranger.
Pour quelles compétences fait-on appel à vous?
DZ: Pour notre faculté d’adaptation. Nous exerçons beaucoup en Italie, mais, parfois, nous intervenons dans des régions où il y a des guerres, des conflits religieux ou interethniques. Nous n’avons pas toujours le matériel nécessaire pour travailler dans des conditions optimales, mais nous nous débrouillons en utilisant les matériaux disponibles et le savoir-faire des autochtones.
CG: Notre tâche principale n’est pas de sauvegarder ou de restaurer des œuvres d’art endommagées, mais surtout de former les gens sur place pour qu’ils puissent ensuite prendre soin de leurs monuments. Nous nous efforçons aussi de leur inculquer la fierté de leur patrimoine culturel et artistique.
Pourquoi intervenir dans des endroits à risque? Le danger vous attire?
CG: Pas du tout. Nous ne sommes pas des soldats; nous n’avons jamais été au front, nous restons dans les musées. Après quelques expériences concluantes avec l’UNESCO, entre autres, sur des terrains difficiles, différentes ONG ont pris l’habitude de s’adresser à nous.
DZ: C’est un choix, pas une obligation. Nous aimons voyager et nous n’avons pas peur… Nous ne nous sommes encore jamais retrouvés face à des kalachnikovs! Peut-être parce que nous ne cachons rien et que nous demandons toujours à nos interprètes d’expliquer notre travail à la population. Nous leur faisons comprendre que nous ne sommes pas là pour prendre position, mais pour restaurer des œuvres d’art qui font partie de leur culture. Ce n’est jamais difficile de parler avec les gens; en revanche, avec les politiques, c’est une autre histoire…
Où a eu lieu votre première expérience en zone de conflits?
DZ: C’était en Ethiopie, en 1980. Ensuite, nous avons été au Kosovo, mais c’était après la guerre. Puis il y a eu la Birmanie, en pleine révolution, le Liban, le Soudan, le Tibet, l’Irak…
CG: En Afghanistan aussi. Je me souviens qu’en entrant dans le musée de Kaboul, nous nous sommes retrouvés devant un amoncellement de pierres. Les talibans avaient démoli toutes les statues bouddhistes, alors que cette religion avait disparu du pays depuis des siècles. Ce qui se passe en Syrie, à Palmyre, montre que les destructions sont programmées, annoncées et filmées uniquement pour attirer l’attention de la communauté internationale. C’est l’ère des médias.
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez?
DZ: Dans certaines régions, nous avons eu des problèmes de langue. Au Tibet, nous avions un interprète qui parlait un peu l’anglais et qui traduisait en mandarin! Les Tibétains ne comprenaient rien et nous non plus. Nous avons parfois eu quelques déconvenues alimentaires ou logistiques, mais quand on souhaite vraiment communiquer, apprendre et enseigner, il y a toujours moyen de se faire entendre.
CG: Les contacts avec la population sont agréables et personne ne nous a encore tirés dessus! Ceux qui pillent et détruisent sont surtout des gens peu éduqués, obéissant à des ordres; ce ne sont jamais les chefs qui passent à l’acte. En fait, à mon avis, un des plus grands dangers, ce sont les mines…
Comment définiriez-vous votre mission?
DZ: Notre engagement consiste principalement à enseigner notre savoir en matière de protection et de restauration. Mais nous apprenons aussi beaucoup des habitants: leurs techniques, les matériaux utilisés, etc. Nous recevons autant que nous donnons.
CG: Les gens sont généralement fiers de leur héritage culturel. Pour reprendre l’exemple du musée de Kaboul, ce sont eux qui nous ont aidé à regrouper les morceaux et à reconstruire les statues. Il n’est pas rare que certains cachent des pièces uniques pour les mettre à l’abri. Un peu comme les Italiens et les Français durant la Seconde Guerre mondiale, pour les dissimuler aux nazis.
Comment empêcher la destruction du patrimoine artistique?
CG: C’est une vaste question. Les mécanismes politiques, religieux et interethniques sont complexes. Il ne suffit pas d’envoyer des soldats pour protéger les œuvres d’art. Tout passe par la connaissance de la culture et de l’autre, ainsi que par la transmission de la passion pour son propre patrimoine. Au Kosovo, par exemple, nous avons travaillé avec des membres d’ethnies parfois en conflit. Grâce à ce but commun de sauvegarde, il n’y avait plus de discrimination religieuse, politique, ethnique. L’animosité avait disparu et après une journée de labeur nous allions manger tous ensemble.
DZ: En histoire de l’art, des cours sont organisés pour expliquer comment protéger des œuvres dans des régions en guerre. Dans le cas de la Syrie, le mieux à faire serait d’ignorer l’Etat islamique qui détruit le patrimoine artistique et culturel afin d’attirer l’attention; mais c’est plus facile à dire qu’à faire. Le plus important reste de sensibiliser la population.
Où aura lieu votre prochaine intervention?
CG: On nous demande souvent pourquoi nous ne sommes pas déjà en Syrie… La réponse est simple: on ne nous l’a pas proposé. Il est vrai que, pour le moment, c’est très dangereux. Quand on aura libéré certaines zones, nous serons en mesure de mieux protéger les bâtiments.
DZ: Nous serons toujours prêts à aller restaurer ce qui peut encore l’être. Tant que nos jambes nous porteront, nous n’hésiterons pas à partir. L’envie reste intacte.
Est-il difficile d’être à la fois conjoints et collègues?
CG: La recette est qu’il n’y a aucune rivalité entre nous. Au contraire, on préfère mettre l’autre en avant. Quand nous travaillons séparément, nous avons besoin de nous parler pour échanger des avis ou des conseils.
DZ: Une vie passée ensemble autour d’une passion commune. Nous nous sommes rencontrés dans la basilique d’Assise en restaurant le «Maestro delle vele» de Giotto; un bon début.
Auriez-vous un message pour les étudiants de l’Université de Fribourg?
DZ: J’aimerais dire aux étudiants en histoire de l’art de ne jamais perdre l’envie d’apprendre, de ne jamais cesser d’acquérir de nouvelles connaissances, de ne pas être sectaires et de garder l’esprit ouvert.
CG: Même si l’on donne de moins en moins de fonds pour la formation et la recherche, il faut continuer à être motivé, à entretenir une certaine élasticité mentale, à s’adapter aux situations inconnues, à développer le côté pratique et pas uniquement théorique. Surtout: restez curieux!
Liens:
- Religion on- et offline - 16.10.2017
- Faire le djihad et mourir - 21.10.2016
- Briser la spirale - 17.04.2016