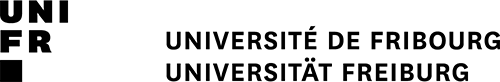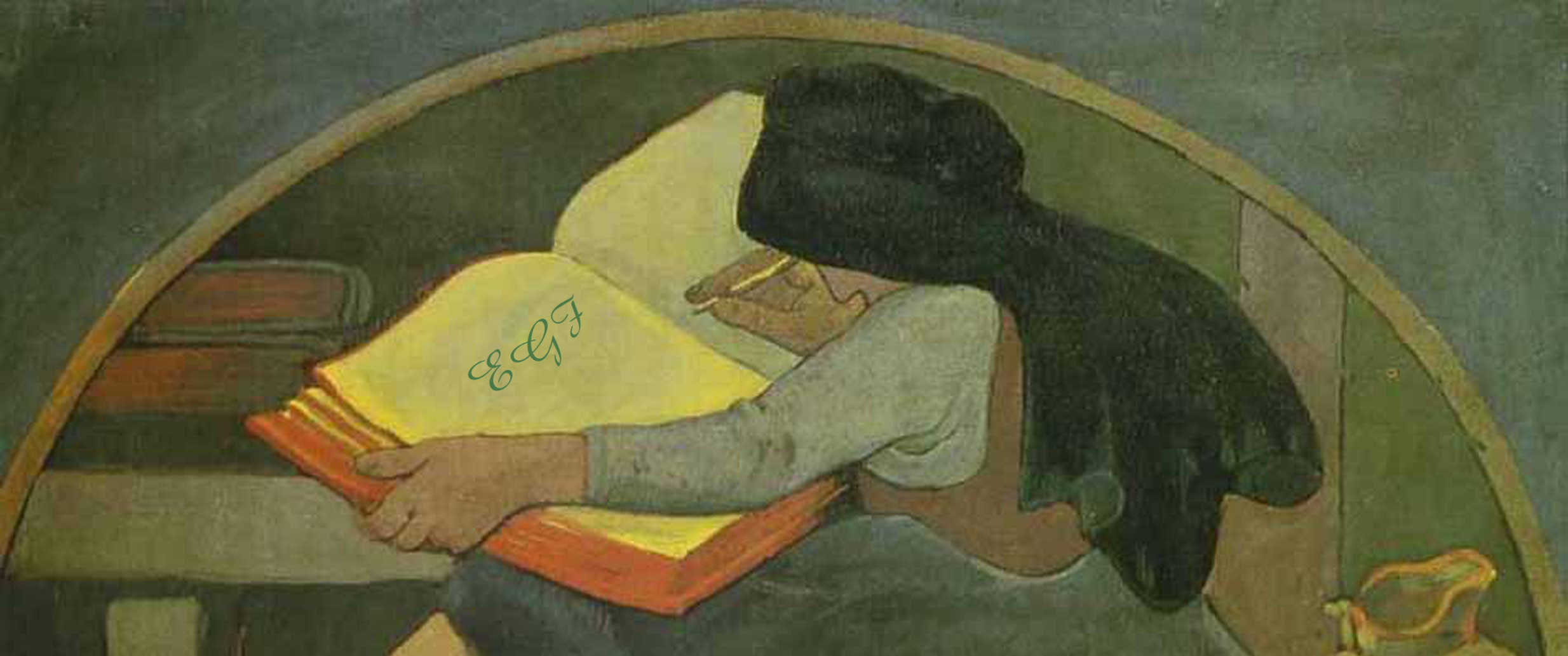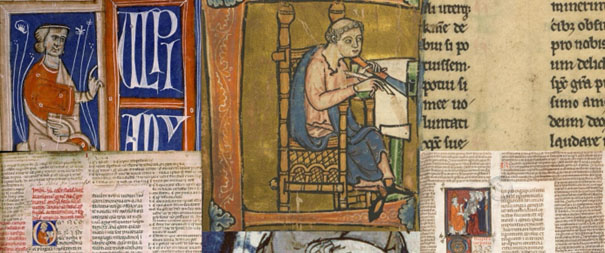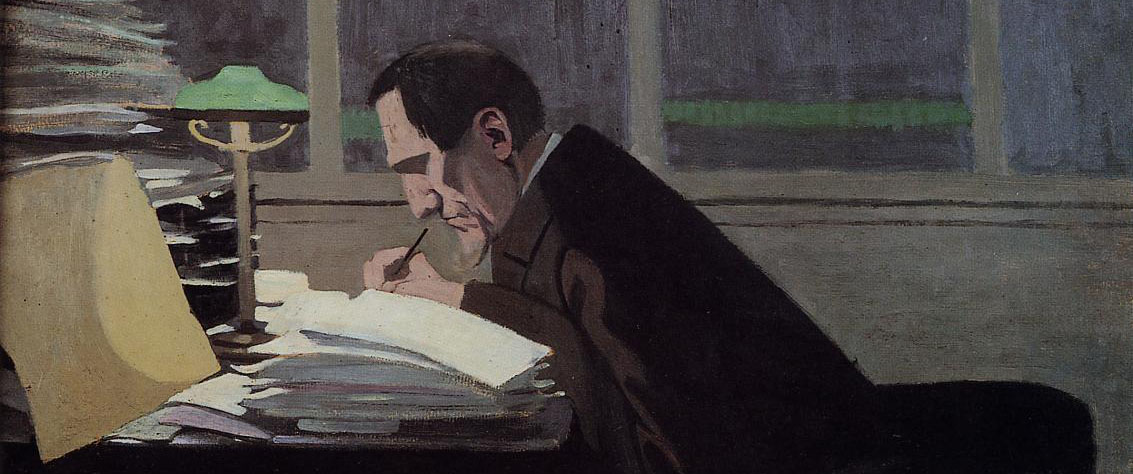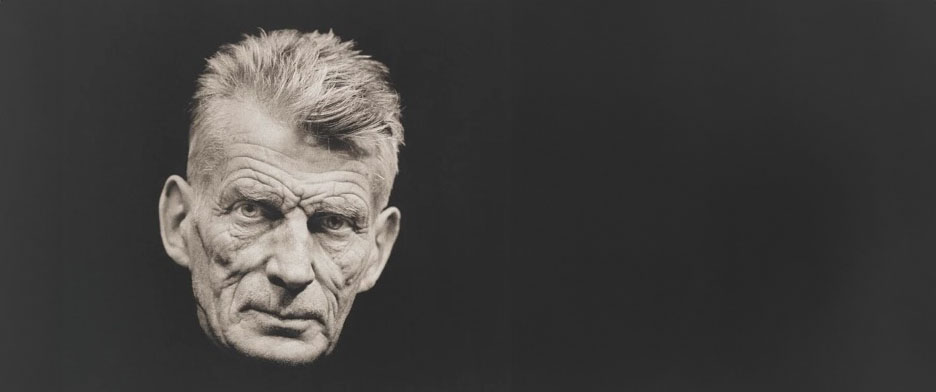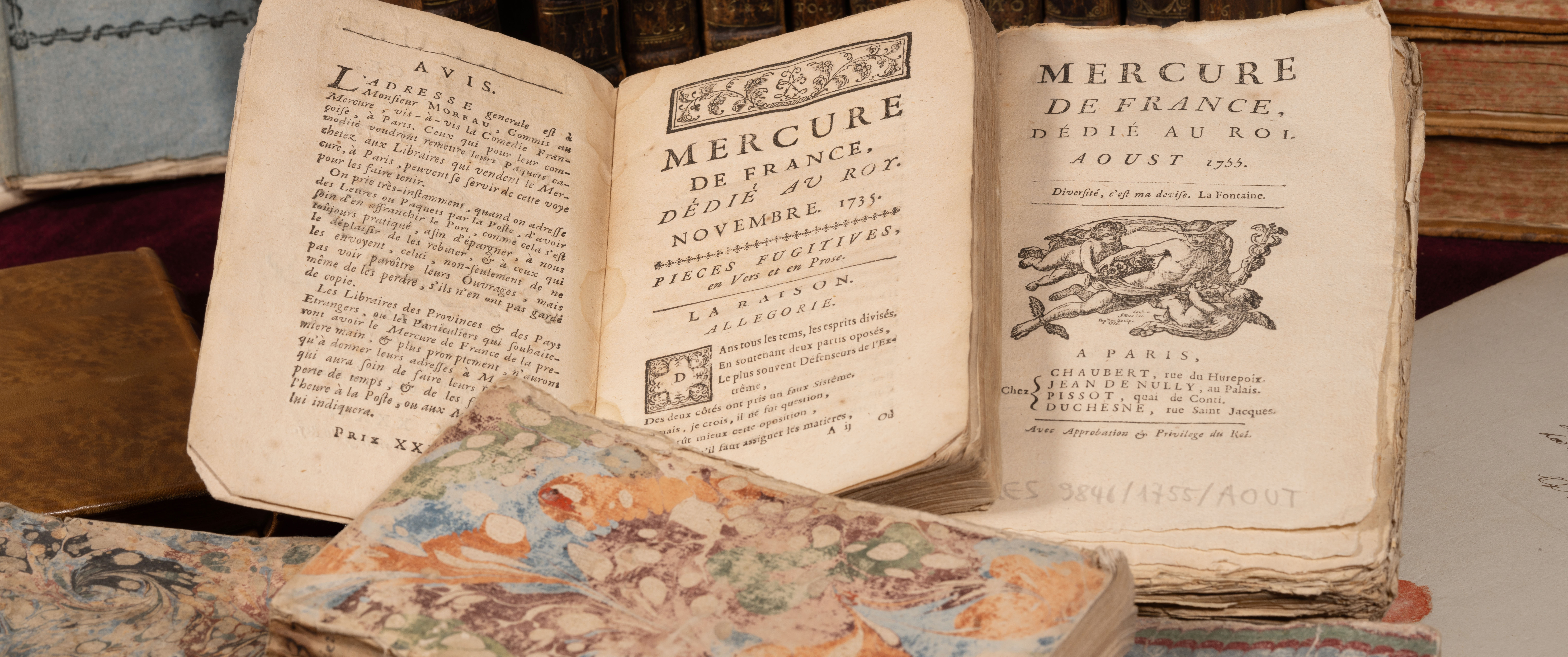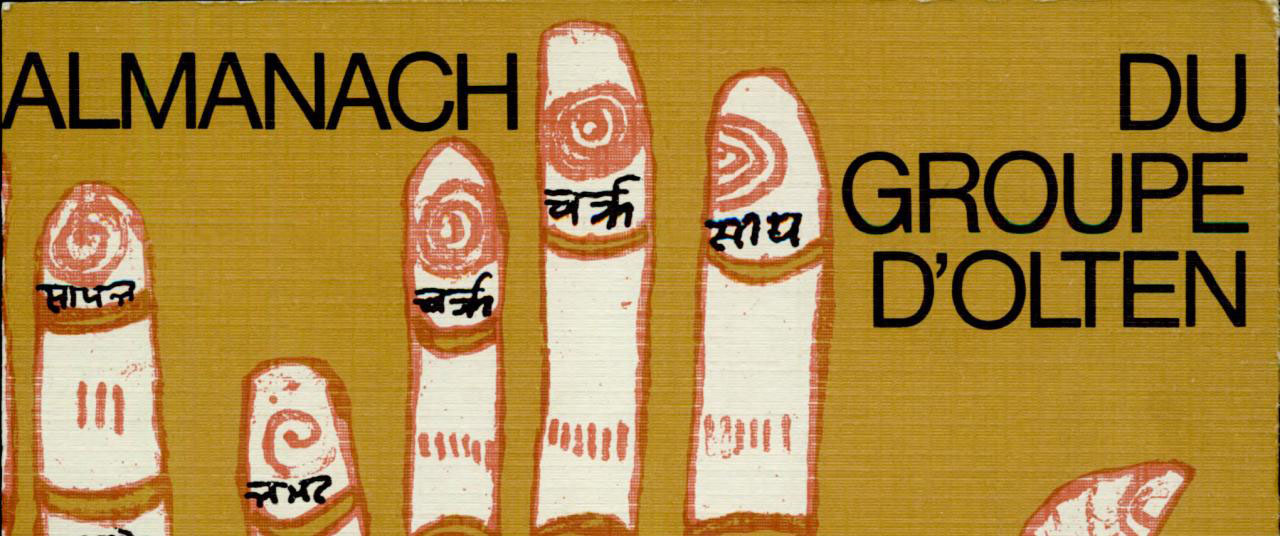La formation s’appuie sur trois piliers : littérature médiévale, littératures classique et contemporaine et linguistique française.
Ouverte à des champs disciplinaires voisins (philosophie, histoire de l’art, histoire, anthropologie), l’étude de la littérature française du Moyen Âge à nos jours embrasse l’histoire de la littérature, des faits et pratiques littéraires, du livre et de la lecture. Les étudiant·e·s profitent en alternance d’enseignements d’histoire et de théorie littéraires, et de séminaires où ils développent leurs capacités d’analyse, de réflexion et d’argumentation. Le cursus comprend des approfondissements en écriture critique et créative.
En linguistique, la formation porte sur le système linguistique et sa mise pratique, que cela concerne le plan formel (phonétique, morphologie, syntaxe) ou l’étude du sens (sémantique) et des mécanismes interprétatifs (pragmatique). Science du langage, la linguistique étudie la production verbale dans ses manifestations les plus variées, en s’appuyant sur les courants et concepts théoriques majeurs, et sur la méthodologie rigoureuse qui lui est propre. Les étudiant·e·s sont formé·e·s dans des domaines aussi diversifiés que l’étude de la variation langagière, du français parlé, des phénomènes énonciatifs, du changement linguistique ou encore de la construction du lexique.
Dans tout type de production langagière (oral ou écrit), un matériau formel, appréhendé par la vue ou par l’ouïe, produit un contenu perceptible par l’esprit (un sens), qui plongé dans un contexte (situationnel, historique, social, culturel) permet de construire une interprétation. L’interaction entre ces trois mêmes dimensions (forme, sens, interprétation en contexte) est appréhendée de manière originale et singulière par les trois piliers de notre formation.
Le Département de Français collabore par ailleurs étroitement avec le Département de Germanistik pour proposer un programme d’études commun intitulé « Français et Allemand : Bilinguisme et échange culturel ».