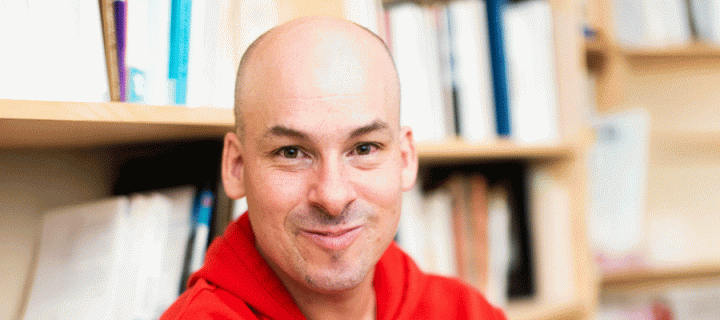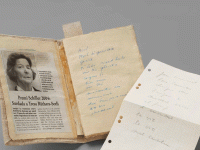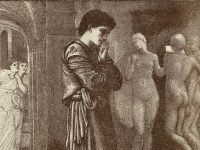Philosophe et écrivain, Alexandre Jollien revient à l’Université de Fribourg, où tout a commencé pour lui, pour une conférence dans le cadre des «La Mobilière Cluster for Resilience Lecture Series». Il y évoque la résilience comme une aventure profondément humaine et collective, nourrie de joie, de liberté et de solidarité.
Alexandre Jollien, vous revenez à l’Université de Fribourg pour proposer une conférence dans le cadre des «La Mobilière Cluster for Resilience Lecture Series». Qu’est-ce que ce concept de résilience signifie pour vous?
Le concept de résilience vient dégager l’horizon. Il ouvre une infinité de possibilités et fait éclater les déterminismes. Nulle vie n’est jamais foutue. Grâce à la solidarité et les ressources intérieures, les chaînes se brisent. Le danger, c’est de récupérer cette magnifique ouverture à la sauce individualiste en mettant les responsabilités du mal-être social dans le seul individu. Il est donc essentiel de rappeler, comme le fait Boris Cyrulnik, que la résilience est une œuvre collective. C’est le fruit d’un «nous». Un défi qui s’accomplit au quotidien grâce à des réseaux solidaires.
Les titres de vos derniers livres – et celui de votre conférence – ont en commun les notions de liberté, de joie, de légèreté, d’insouciance… Comment remettre de tels concepts au centre face à l’actualité et aux pressions politiques et sociales ambiantes?
Chögyam Trungpa, un maître tibétain, avait coutume de balayer les soucis de l’ego par trois lettres: CCL, Couldn’t Care Less… L’insouciance, la légèreté et la joie ne congédient pas la responsabilité. Au contraire, c’est un appel à l’action. Une fois dégagé des encombrements de l’ego, on peut poser des actes, s’engager pour une société solidaire, plus juste, plus équitable. La joie est aussi un gouvernail qui aide à s’extraire des passions oppressantes que sont le ressentiment, l’amertume. Il s’agit d’une plateforme pour s’engager.
De nombreuses recherches montrent ces derniers mois que la jeunesse en particulier souffre de cette angoisse existentielle par rapport à une certaine «marche du monde», quels conseils donneriez-vous à nos étudiant·e·s?
Avec l’éclipse des repères religieux et l’avancée d’un matérialisme et de l’individualisme, on peut se sentir vide devant le vertige, le tragique de l’existence. A mes yeux, vivre une vie accomplie s’articule autour de trois axes: d’abord, pratiquer un chemin vers l’intériorité, descendre au fond du fond comme dirait Maître Eckhart. Il s’agit aussi de bien s’entourer. Nous sommes tous des coéquipiers et le voyage ne saurait se faire en solitaire. Enfin, je pense qu ‚œuvrer à l’amélioration du monde en s’engageant peut donner sens à une vie. Là aussi, il s’agit de passer du «je» au «nous». Ce sont les deux chantiers de la vie spirituelle: sculpter une singularité, découvrir une liberté intérieure et poser des actes, contribuer au vivre ensemble.
Vous nous invitez également à nous départir de notre «costard social», à ne pas nous laisser aliéner par le regard de l’autre. Aujourd’hui, j’ai l’impression que nous naviguons entre des injonctions contradictoires: une tendance est au diagnostic, à la case, à la prédéfinition de soi, tandis que même les réseaux sociaux, haut lieu d l’apparence, nous incitent à l’authenticité, au naturel. Comment garder son cap entre ces deux vagues?
Ramana Maharshi a atteint l’éveil en se posant une question : Qui suis-je? Au lieu d’y répondre en multipliant les étiquettes, il s’agit de se dépouiller, de se désidentifier de son corps, de ses idées, de ses convictions pour atteindre le soi. Concrètement, qui suis-je? Quelle est mon identité? Les réseaux sociaux peuvent nous entraîner dans la spirale de la comparaison. Ils peuvent aussi être la plateforme où l’on peut échanger, plonger dans l’authenticité. Tout est question d’équilibre. Ai-je besoin d“être validé? Que représente pour moi autrui? Kant parlait de l’insociable sociabilité de l’homme. Il y a en nous comme deux tendances. L’une à s’approcher de ses congénères, l’autre à se démarquer. Le défi, c’est d’aller vers l’autre par générosité, par don, vivre de l’amour inconditionnel. L’urgence est de promouvoir cet amour inconditionnel dans notre éducation, de donner les clés pour bâtir une liberté intérieure et s’affranchir du regard de l’autre tout en participant pleinement à la vie sociale. Il n’y a pas de recette ni de mode d’emploi. Nous sommes invités, pas à pas, à sculpter cette singularité en se connectant réellement aux autres.
Revenir à l’Université de Fribourg, c’est aussi revenir sur vos premiers pas en philosophie. Quels souvenirs gardez-vous de cette période?
Dans ma vie, l’Université de Fribourg et ses professeurs, mes camarades de classe ont été, précisément, l’occasion d’une résilience. La formation que j’y ai reçue me nourrit encore aujourd’hui. Elle m’a donné des outils de libération, une vocation, quelques pistes et une boussole. Je suis infiniment reconnaissant à l’alma mater. Sans elle, je ne serais pas ici. Des souvenirs? Le sentiment de m’ouvrir au monde, de trouver ma vocation, d’être réellement épaulé par des professeurs. C’est aussi la période de mon premier ouvrage, L’Eloge de la faiblesse, une véritable naissance. Je suis tellement heureux de retourner dans ce lieu qui a participé à une deuxième naissance.
- Infos sur les «La Mobilière Cluster for Resilience Lecture Series»
- Infos sur la conférence avec Alexandre Jollien
- Agenda
Image: Aurélie Felli
- «Le monde est redevenu un monde extrêmement brutal» - 25.11.2025
- « Il y a toujours quelque chose de possible» - 24.11.2025
- «Si on avait toutes les cartes en main, il n’y aurait pas de crises» - 24.11.2025