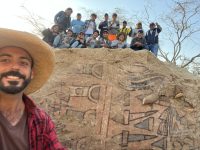Dans son dernier livre, le socio-anthropologue François Gauthier revient sur les métamorphoses du religieux dans un monde où domine l’économie de marché: «Nous vivons une transformation de ce qu’est la modernité.»
Concept phare depuis des décennies dans le champ des études sociales sur le religieux en modernité, monstre presque sacré, la sécularisation décrit le processus par lequel la religion perd progressivement de son influence dans la société, surtout dans les domaines politiques, culturels et économiques. Ainsi comprise, elle conduirait le religieux à se redéployer en dehors des institutions traditionnelles sur un mode individuel.
Une perspective sur laquelle François Gauthier porte un regard critique: «Aujourd’hui, on perpétue ce récit d’une sortie de la religion dans tous les pans de la société. Or, ce déclin est celui du modèle du christianisme paroissial dans nos contrées, mais à l’échelon global, la religion ne décline pas. Elle prend de nouvelles formes.»
Socioanthropologue du religieux et professeur ordinaire au Département des sciences sociales de l’Université de Fribourg, il observe une rupture dès les années 1960. «Nous vivons une transformation de ce qu’est la modernité», dit-il, contestant l’idée d’une postmodernité caractérisée par un émiettement des valeurs et référents sociétaux, y compris religieux. «Cette transformation conduit au contraire à un tout cohérent qui ne se réduit pas à la sphère individuelle, mais s’inscrit dans des mouvements macro-sociétaux.»
Un regard biaisé
Cette cohérence, c’est ce qu’il s’attache à démontrer dans son dernier livre Religion in the market era. The rise of market islam, the revenge of Confucius, and other stories from a global age (Routledge, 2025). Un ouvrage passionnant qui s’inscrit dans la continuité d’un premier opus (Religion, Modernity, Globalisation. Nation-State to Market, Routledge, 2020), dans lequel il décrivait le redéploiement du religieux à l’heure de l’économie de marché.
La méthode François Gauthier tient, au fond, dans une rééducation de notre regard. «L’idée de sécularisation déforme nos lunettes, comme si l’Occident se trouvait à la pointe de l’histoire. Dans une telle perspective évolutionniste, l’islam, par exemple, se trouve relégué au rang d’obscurantisme. Mais avec ce regard biaisé, on passe à côté d’évolutions majeures.» Là encore, on confond selon lui christianisme occidental et religions globales.
Trouver son «moi» avec Billy Graham
Pour nettoyer nos lunettes, le chercheur propose cette fois-ci de s’arrêter sur des cas concrets. Une analyse empirique qui fait tout l’intérêt de cette «suite», là où le premier ouvrage était consacré à décrire le cadre théorique de cette mutation globale du religieux. Pour François Gauthier, deux tendances marquent les transformations du religieux à l’ère du néo-libéralisme: la religion comme life style et le conservatisme de type charismatique.
«Ces deux tendances ne s’opposent pas. Elles peuvent même se rejoindre et s’alimenter l’une l’autre. Prenez le cas du pasteur évangéliste américain Billy Graham (1918-2018). Tout en ancrant son message dans un conservatisme moral, ce prédicateur à succès prônait une approche personnelle de la foi, vue comme une force de transformation intérieure. L’objectif était alors de trouver son «moi», de l’exprimer», explique le chercheur.
En Chine, après Mao
Ces transformations doivent se comprendre dans le cadre plus large de la globalisation. «Depuis la fin du XIXe siècle, nous sommes un monde», rappelle François Gauthier. «Nous sommes passés du modèle de l’Etat-Nation à un modèle néo-libéral dans lequel le global prend toute sa consistance.» Il cite le cas de la Chine. Avec l’instauration de la République populaire sous Mao, le nombre de temples a fondu. «Sur environ 1 million de temples que le pays comptait en 1900, il n’en restait presque plus à la mort du dictateur en 1976.»
Le mouvement s’inverse dès les années 1980: les constructions explosent. Au tournant du XXIe siècle, la Chine compte ainsi quelque 2 millions de temples (la plupart étant indépendants). Comment l’expliquer? «Le pays est passé d’une économie planifiée à une économie de marché. Le régime s’est mis à utiliser la religion à des fins économiques. Car renouer avec la culture chinoise millénaire permettait de forger une identité dépassant les frontières du pays, ceci pour aller chercher des capitaux qui se trouvaient à Hong Kong, Taiwan, en Malaisie et à Singapour.»
Exemple parlant de cette récupération du religieux (le régime parle de «culture») par les autorités: la divination. Tradition millénaire en Chine, celle-ci a longtemps été interdite sous le communisme, mais les temps ont changé et le régime tolère désormais sa pratique. Autre situation, celle du Falun Gong, un mouvement inspiré du Qi gong qui voit le jour en 1992. Ce mouvement connait un essor rapide en Chine et dans le monde entier, mais il était indépendant, voire critique, du régime, ce qui lui a valu d’être combattu par Pékin.
Hallal et mode islamique
Parmi les autres pans de la religion en modernité sur lesquels se penche François Gauthier: l’islam. Durant une bonne partie du XXe siècle, les islamistes avaient pour stratégie de prendre le pouvoir politique. «Ces mouvements, apparus pour la plupart avec la profonde transformation qu’a connue l’islam à la fin du XIXe et au début du XXe siècle, visaient à islamiser la société grâce à l’Etat», fait-il remarquer. Les spiritualités échappant à ce contrôle, comme le soufisme, subissaient une forte répression.
Les choses changent dans les années 1980. «Les pays musulmans s’ouvrent au marché mondial, la classe moyenne consomme la télévision et se met à chercher un sens à sa vie à l’extérieur des formes de l’islam institutionnel», explique François Gauthier. De nouveaux gourous émergent, à l’image de l’Egyptien Amr Khaled, un ancien banquier prônant un islam de la prospérité, tandis que le soufisme fait son retour avec une spiritualité plus personnelle.
«Allah passe d’une figure austère et rageuse à une figure d’amour et de bienveillance», souligne le chercheur. Dans le sillage de cette perspective, l’islam politique cherche à islamiser les mœurs et non plus l’Etat. «La religion devient un style de vie. La mode islamique apparaît dans les années 1980, de même que le hallal devient un phénomène qui explose à partir des années 1990. Dans un monde globalisé, être musulman ou musulmane, c’est d’abord apparaître comme tel.»
«D’un côté, on a donc un islam de type new-age et, de l’autre, un conservatisme avec des règles strictes. Dans ce sens, on peut voir l’arrivée au pouvoir des islamo-conservateurs de l’AKP en Turquie comme l’expression de l’institutionnalisation de cette transition. C’est un exemple parlant. Les transformations viennent de la culture d’abord, elles s’institutionnalisent ensuite.»
L’orthodoxie comme valeur refuge
François Gauthier s’arrête également, dans son livre, sur les transformations du religieux dans les pays de l’ancien Bloc de l’Est. «Comme en Chine, la religion y a été réprimée par le communisme. Mais elle a survécu.» Pour les pays de l’ex-URSS, la rupture intervient en 1991, avec la dissolution de l’Union soviétique. Dans une Russie fragilisée à tous les niveaux, y compris sur le plan identitaire, l’orthodoxie connaît alors une forte croissance, même si les gens pratiquent peu ou prou. Elle apparaît comme une valeur refuge, capable de renforcer l’identité nationale.
«Le conservatisme de type charismatique s’exprime ici par la tradition, mais sur un mode pro-capitaliste. Là aussi, une théologie de la prospérité voit le jour. L’orthodoxie développe une spiritualité qui s’érige en opposition à la mode du New Age occidental. C’est la raison pour laquelle le New Age, s’il existe aussi en Europe de l’Est, est moins contre-culturel qu’ailleurs», explique François Gauthier.
__________- Gauthier, F. (2025). Religion in the market era: The rise of market Islam, the revenge of Confucius, and other stories from a global age (1st ed.). Routledge. (en accès libre)
- François Gauthier
- Santé: un HUB pour soigner et former - 09.12.2025
- Antiquité: Les temples, de vrais acteurs économiques - 03.11.2025
- Allah, Jésus et Confucius à l’ère du life style - 19.08.2025