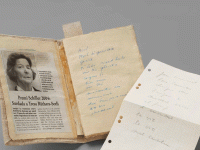Le Professeur Emmanuel Alloa vient de vernir une vaste exposition, dont il est le commissaire associé, à la Galerie nationale du Jeu de Paume à Paris. «Le supermarché des images» interroge le flot sans fin de la production photographique actuelle et remet en question notre lien aux images, ainsi que le lien de celles-ci à l’économie.
Professeur Alloa, vous êtes le commissaire associé de l’actuelle exposition du Jeu de Paume à Paris. En quoi consiste ce rôle?
L’art contemporain a toujours entretenu un rapport étroit avec la philosophie. Comme dans toute pensée rigoureuse, dans l’art et a fortiori dans l’art contemporain, il faut être disposé à tout remettre en question, à se méfier des habitudes. C’est d’ailleurs l’une des idées que j’essaie de transmettre à mes étudiant·e·s à Fribourg, au sein de la Chaire d’esthétique et de philosophie de l’art, car c’est une occasion formidable de mettre en œuvre la réflexion philosophique – face aux œuvres elles-mêmes. L’art contemporain est très demandeur, qu’il s’agisse de collaborations avec les artistes ou d’une écriture sur leurs œuvres; pour la philosophie, cela nous confronte à des objets nouveaux et souvent déroutants.
Mais cette fois, il s’agit d’une autre gageure encore. La Galerie nationale du Jeu de Paume, située dans le Jardin des Tuileries à Paris, a fait le pari de miser sur une approche plus philosophique pour imaginer une exposition tout entière. C’est ainsi qu’il y a trois ans, le philosophe et musicologue Peter Szendy a été invité à faire une proposition d’expo, et qu’ensuite Marta Ponsa et moi-même avons rejoint ce projet passionnant en tant que commissaires associés. Marta, responsable de la programmation culturelle du Jeu de Paume, apportait tout son savoir-faire et sa connaissance de l’art en train de se faire, tandis que je venais renforcer le pôle conceptionnel. Mais, de fait, nous avons constamment travaillé à trois, de concert, et surtout avec toute l’équipe du Musée, pour mettre cette expo sur pied.
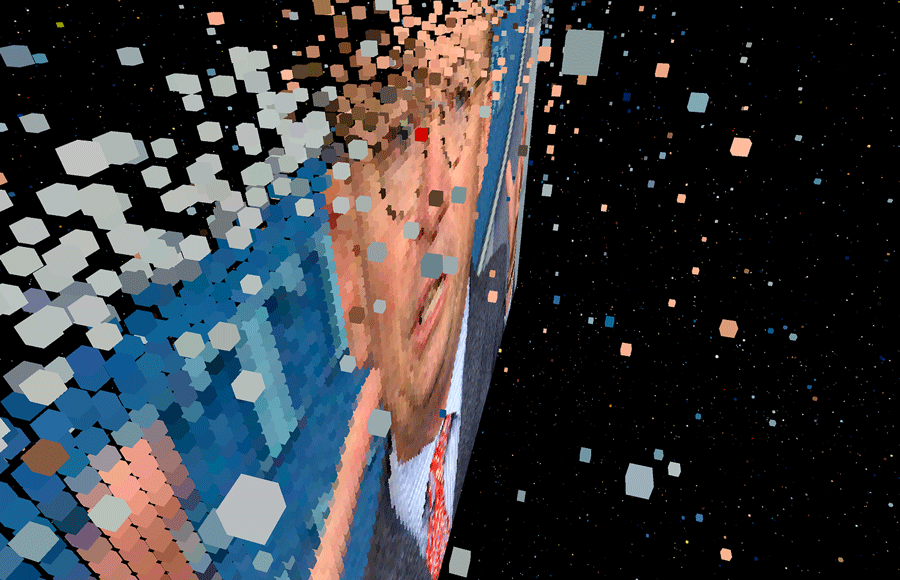
© Jeff Guess
L’exposition s’intitule «Le supermarché des images», n’est-ce pas un peu l’antithèse de la mission d’un musée?
Le titre se veut, bien sûr, un brin provocateur et on ne trouvera évidemment pas grand-chose de prêt-à-consommer. Il reprend et déplace, en fait, celui d’un livre de Peter [Szendy], qui constitue en quelque sorte le point de départ de l’expo – Le supermarché du visible. Essai d’iconomie (Minuit, 2017). Il s’agissait déjà de prendre la mesure du gigantesque bouleversement en cours, de cette révolution des nombres qui modifie profondément notre régime de visibilité: chaque jour, plus de trois milliards d’images s’échangent sur les réseaux sociaux. De récepteurs d’images, nous sommes devenus aussi leurs émetteurs, puisqu’il n’est plus besoin de demander l’acceptation d’une corporation de Saint-Luc, comme au Moyen-Age, pour avoir le droit d’en réaliser. Mais cette démocratisation nouvelle des outils d’enregistrement et de diffusion fait également face à de nouvelles concentrations: les banques d’images et la stock photography sont autant de symptômes d’un temps qui n’est plus celui des créateurs, mais des gestionnaires. La valeur d’une image se mesure moins à sa virtuosité qu’à l’attention qu’on lui prête, dans un univers où cette attention, justement, semble bien volatile.

© Geraldine Juàrez
Pas de rayonnages ni d’étalages donc: dans cette exposition, c’est plutôt le supermarché que nous souhaitions questionner, cette grande place de marché désormais mondialisée où s’échangent et se négocient les visibilités. Par quels canaux de distribution les images circulent-elles? Comment sont-elles qualifiées et quantifiées, cataloguées et vendues? A quelle vitesse se propagent-elles et sur quels écrans défilent-elles? Quelles énergies sont nécessaires à leur mise en mouvement, mais aussi à leur stockage? Quelles matières premières concourent à leur fabrication? Bref, quelle est aujourd’hui l’économie des images? Et inversement, comment peut-on, par la prise des images, aborder les rouages d’une logique qui échappe généralement à la figuration: l’économie? Depuis la crise financière de 2008, nous tentons de trouver des parades à des processus par nature évanescents, et de nous réapproprier des moyens pour nous les représenter. L’exposition mobilise donc ce que l’on pourrait appeler l’hypothèse «iconomique»: que parvenons-nous à comprendre du monde, en couplant la question de l’image à celle de l’économie, et dans quelle mesure n’est-ce pas une facilité de langage que de considérer qu’entre image de l’économie et économie de l’image, il y a un lien fort?
En ce qui concerne la mission du musée, pas de risque, elle n’est pas mise en péril: on y verra essentiellement des œuvres d’artistes visuels contemporains, conformément à la vocation du Jeu de Paume, qui a pour mission d’être une plateforme pour les images contemporaines sous toutes leurs formes.
L’exposition part du présupposé que nous vivons dans un monde saturé d’images. Existe-t-il une limite? Peut-il y en avoir trop?
Le constat de la saturation, Walter Benjamin le faisait déjà en 1929, lorsqu’il évoquait un monde «chargé à cent pour cent d’image». On peut l’interpréter de différentes manières. On peut tout d’abord considérer que l’on sera en peine de trouver des recoins de la planète encore vierges de toute figuration, et qu’après la colonisation planétaire des images, avec la nanotechnologie, plus qu’en extension, c’est désormais dans l’infiniment petit que pénètre la visualisation scientifique. Mais on peut aussi y entendre l’écho d’une lassitude: à quoi bon continuer à prendre de nouvelles images d’un lieu quand une autre, sans doute meilleure, est déjà disponible à distance d’un clic? C’est d’ailleurs le drame du métier de photographe professionnel qui, en l’espace de quelques décennies, s’est vu concurrencer par la photographie amateur, plus mobile et réactive, mais surtout par les banques d’images, où semble déjà stocké tout l’inconscient optique de l’humanité. Enfin, on peut donner un troisième sens encore à la saturation: être saturé, c’est être repu et rassasié. Le sommes-nous réellement? On peut le croire, au vu des effets anesthésiants de certains médias: face à certains drames retransmis à distance, nous sommes devenus complètement insensibles. Il suffit de penser au destin tragique des migrant·e·s, qui se scelle pourtant quotidiennement aux portes de l’Europe, et auquel nous nous sommes tristement habitués, ou, mieux encore, au drame syrien, qui n’émeut plus personne, après huit ans de guerre civile. Ceci dit, sur d’autres aspects, nous sommes loin d’être repus, et les iconophiles que nous sommes n’ont jamais été aussi gourmands. La pulsion scopique, cette force qui nous pousse à voir, encore plus et encore mieux, s’accommode mal d’un constat de saturation.
Peut-il y avoir trop d’images, me demandez-vous. Impossible d’y répondre comme cela. Ce qui est certain, c’est qu’il y en a qui produisent des effets de sidération et de capture, et qui inhibent nos capacités à penser et à construire du commun, tandis que d’autres, au contraire, contribuent à nous faire voir ce que nous ne voulions pas voir ou que nous n’avions pas assez bien perçu. Certaines images nous enferment dans le cliché, d’autres, au contraire, nous permettent de nous confronter à autre chose qu’à la sempiternelle répétition du même. Des premières, à mon goût, il y en a trop, en effet; des dernières, il n’y en aura jamais assez.
Des questionnements posées autour de l’exposition est née une nouvelle science, en quelque sorte. L’iconomie ou l’économie des images. De quoi s’agit-il et est-ce vraiment un questionnement nouveau ?
Oui et non. L’hypothèse iconomique que Peter [Szendy] propose dans son dernier ouvrage rejoint celle que nous avions mise à l’épreuve lors d’un projet de recherche financé par le Fonds national suisse, dans le cadre du Pôle national suisse Eikones sur la critique de l’image, à Bâle, avec ma collègue historienne Francesca Falk (le livre collectif BildÖkonomie. Haushalten mit Sichtbarkeiten, Fink, 2013, présente le fruit de ce travail). Nous nous étions inspirés d’autres travaux importants comme ceux de Jean-Joseph Goux, mais surtout du travail pionnier de Marie-José Mondzain (que l’on pense à son magnifique Image, Icône, Economie. Les sources byzantines de notre imaginaire contemporain, Seuil, 1996, lui-même précédé d’autres études). Car en fait – et c’est que souligne déjà Marie-José Mondzain – ce sont les théologiens de Byzance qui inventent l’économie de l’image, lorsqu’ils soulignent que l’économie du salut passe par un problème de l’image. Lorsque nous parlons d’iconomie aujourd’hui, nous n’inventons pas vraiment un nouveau mot: nous ne faisons que prononcer le mot «économie» comme on le prononçait à Byzance, comme une «iconomie» (c’est encore le cas du grec moderne, où l’icônomie et l’économie se confondent).
Pourquoi donc faire une hypothèse iconomique aujourd’hui? Eh bien parce que, si de tout temps, les images se sont vu attribuer une valeur (ou se sont vu refuser toute valeur, comme dans une certaine tradition intellectualisante de la métaphysique européenne), aujourd’hui, les images ne se contentent plus d’avoir une valeur, elles sont une valeur. Elles permettent d’abstraire ou de concrétiser et, souvent même, de se substituer à ce qu’elles sont censées représenter. Les images font objet de toutes les capitalisations aujourd’hui, on les achète et on les vend, et elles créent de la dette parmi ceux qui les contemplent. Faire l’hypothèse économique, c’est donc poser à nouveau la question de leur valeur d’usage, et ce à l’instant même où elles semblent se retirer vers un espace intangible et inaccessible. Bref, comment remettre la main sur ces images qui sont faites de nous à notre insu, et qui sont ensuite revendues, sous forme des métadonnées monnayables ? En somme, comment nous réapproprier des images et les remettre en circulation, de manière libre et non soumise?
Que voit-on dans l’exposition?
L’exposition utilise l’intégralité du Musée, sur les trois niveaux, et elle permet de voir 68 œuvres de 48 artistes venant des horizons les plus divers et travaillant sur les supports les plus variés. De la photographie, bien sûr, conformément à la tradition du Jeu de Paume, mais aussi des installations, de l’image en mouvement, vidéo, sculpture, des œuvres réalisées spécifiquement pour le site et même une performance, à voir durant les 3 premières semaines de l’exposition, ainsi qu’une installation sonore. L’expo est organisé selon un phrasé en 5 mouvements, dont chaque titre fonctionne aussi bien comme terme économique que pour désigner ces nouvelles réalités du visible: stocks, matière première, travail, valeur, échanges. Bien que l’accent soit clairement mis sur la création contemporaine, nous avons tenu à montrer que les artistes des générations précédentes avaient déjà anticipé nombre de questionnements qui sont aujourd’hui les nôtres. Le parcours sera donc ponctué par quelques incises qui peuvent paraître plus anachroniques – Moholy-Nagy, Hans Richter, Yves Klein, Les Frères Lumière, Richard Serra – et qui donnent pourtant, nous l’espérons, de l’effet de champ à notre propos. Parmi les surprises des années 1920, il y a une présentation des carnets de Sergeï Eisenstein sur le film jamais réalisé sur Le Capital de Karl Marx, ainsi que les tables analytiques de Kazimir Malevitch, qui donnent à voir ce que celui-ci qualifiait déjà, à l’époque, d’«économie des images».
Bref, je crois qu’il y aura de quoi intéresser toute personne ayant à cœur d’interroger ces réalités inédites qui innervent notre quotidien. L’expo sera ouverte jusqu’au 7 juin et j’emmènerai en tout cas mes étudiants pour un voyage d’études.
__________- «Le monde est redevenu un monde extrêmement brutal» - 25.11.2025
- « Il y a toujours quelque chose de possible» - 24.11.2025
- «Si on avait toutes les cartes en main, il n’y aurait pas de crises» - 24.11.2025