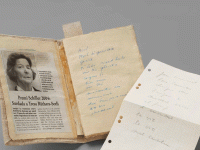2017, année du centenaire de la Révolution russe et d’exposition médiatique intense pour Jean-François Fayet. Notre spécialiste des mondes russe et soviétique a dû se démultiplier pour répondre aux sollicitations des journalistes. Une exposition médiatique jubilatoire, mais pas recherchée à tout prix.
Cette année, les médias vous ont invité à plus d’une dizaine de reprises, afin d’évoquer le centenaire de la Révolution russe. Est-ce que vous appréciez de vous trouver ainsi sous les feux de la rampe?
Dans le mesure où mes interventions dans l’espace public furent surtout textuelles, voire radiophoniques, à l’exception d’un documentaire diffusé sur la RTS2 un dimanche soir, je conserve un plaisant anonymat hors des milieux académiques, voire journalistiques.
Est-ce que cette notoriété soudaine peut vous être profitable en tant qu’historien, par exemple pour vendre votre ouvrage intitulé Le Spectacle de la révolution?
La crédibilité scientifique ne se construit pas au travers des médias, mais cela fait plaisir aux éditeurs, aux services de communication des universités, aux bailleurs de fonds de toute sorte, et facilite ainsi certaines de nos démarches; mais l’essentiel se joue ailleurs: projets antérieurs, comptes rendus scientifiques, expertises externes, réseau scientifique… Nous avions un bon sujet, les compétences, et bien sûr l’intuition qu’en plus d’être une recherche novatrice, elle bénéficierait d’un supplément d’attention médiatique en lien avec le centenaire.
Etes-vous enclin à choisir des sujets de recherche en fonction de l’intérêt qu’ils pourront susciter auprès de médias généralistes?
Encore une fois, le temps de la recherche s’inscrit dans la longue durée (minimum trois à cinq ans) et il serait bien hasardeux de se lancer dans une recherche historique à partir de considérations médiatiques, toujours si fluctuantes, ou même de modes académiques. Qui aurait pu dire il, y a une quinzaine d’années, alors qu’elle ne suscitait plus guère d’intérêt, que la Russie redeviendrait un sujet porteur, dans les médias comme au sein du monde académique?

Est-ce que les journalistes et les historiens souffrent de «commémorite» aiguë? La Révolution russe est certes cruciale, mais on a l’impression que le moindre événement est motif à des nouvelles publications…
Les historiens ne sont pas les initiateurs, même s’ils sont parfois les complices, de ce que d’aucuns qualifient d’hystérie commémorative. J’aurais même tendance à considérer que les commémorations constituent un piège pour l’historien: piège des subventions plus faciles à obtenir (pour un colloque, une publication), cela pourrait nous rendre paresseux, dépendants; et piège de l’instrumentalisation politique, ce que les historiens dénomment les usages politiques du passé. Car les commémorations procèdent d’une volonté politique de mémoire. A l’occasion des fêtes commémoratives, le pouvoir, ou une communauté humaine, s’entoure de représentations collectives qui lui permettent de construire sa légitimité à travers le lien tissé entre le passé et le présent, à travers la création d’un réseau de références historiques mythifiées. C’est en partie pour échapper à ce piège, celui d’une histoire répondant à une demande politique, que nous avons décidé de renverser la perspective en étudiant non pas l’évènement lui-même (les révolutions de 1917), mais l’histoire des commémorations de l’évènement. Moments forts de la mise en scène du pouvoir, les pratiques commémoratives sont toujours pour l’historien un indicateur pertinent de la culture politique du régime qui les produit.
Mais les commémorations relèvent aussi de la catégorie du marronnier journalistique et, depuis la TV, du rituel médiatique par excellence. La surenchère commémorative (une brève recherche sur Google confirme cette tendance d’année en année) s’accompagne ainsi de la concurrence des victimes qui, depuis quelques décennies, ont pris le pas sur les grandes figures historiques ou artistiques, ainsi que les batailles, les traités de paix. Mais dans notre monde où une commémoration suit l’autre, car on prête à la commémoration un rôle moral, les retours de mémoire relatifs aux tragédies du siècle écoulé — guerres mondiales, révolutions, génocides — se mêlent ainsi allègrement à de pures opérations commerciales (pensons à Halloween) et l’histoire qui est de fait mobilisée par ces célébrations n’est pas toujours de même nature.

Peut-on désormais parler de la Révolution russe sans craindre de se voir étiqueter d’historien marxiste ou, au contraire, d’historien bourgeois?
C’est, me semble-t-il, l’une des bonnes nouvelles de ce centenaire. Au-delà de la distance temporelle avec l’événement fondateur, c’est le temps passé depuis l’effondrement du système communiste en Europe de l’Est qui a permis une approche largement désidéologisée de la révolution, loin du manichéisme du Cinquantenaire et même de l’historiographie exclusivement à charge des années 1990. Le siècle soviétique (1917-1991) appartient désormais au passé, entendu dans le sens d’une séquence close de l’histoire. Ce n’est plus une histoire en train de se faire, susceptible de peser sur les questions politiques actuelles. Ainsi, à défaut d’avoir été toujours avant-gardistes, la plupart des expositions historiques (Zurich, Paris, Saint-Pétersbourg…) consacrées à l’événement ont bien mis en valeur la complexité des troubles révolutionnaires qui traversèrent la Russie en 1917 et le lien avec la Grande Guerre. A ce titre, les révolutions russes ont retrouvé leur place au sein de notre histoire commune et de notre mémoire collective.
En tant qu’historien, que pouvez-vous dire sur la Révolution russe qui n’ait pas déjà été ressassé à l’envi?
Le scoop historique a beaucoup marqué la recherche historique sur l’Union soviétique des années 90, la raison en était l’ouverture presque quotidienne de nouveaux fonds d’archives, après des décennies de diète documentaire. Les temps ont changé. Mais si je vous disais que les révolutions russes s’inscrivent dans un continuum de crises allant de 1914 à 1921 et que cette histoire n’est que le versant oriental de ce que fut la Grande guerre à l’Ouest, n’est-ce pas trop ressassé?
Quand le spécialiste débarque dans les médias généralistes
Dans les médias audio-visuels, les réponses doivent être très courtes. N’est-ce pas difficile de résumer des années de recherche en quelques minutes seulement?
Il existe, notamment grâce au service public et à la presse locale, quelques médias offrant des temps de parole adaptés à notre discipline. La radio bien sûr – «Histoire vivante», «Babylone»…, parfois même «Forum» –, mais aussi la presse écrite. J’ai bénéficié à plusieurs reprises d’une pleine page (8 à 10’000 signes), cela permet d’appréhender la complexité des choses. Dans tous les cas, il ne saurait être question d’entrer dans la quotidienneté de la recherche historique, peu spectaculaire en tant que telle.
Comment procédez-vous pour vous adresser à un public non initié?
L’histoire, c’est d’abord raconter des histoires; je ne connais pas de public totalement rétif à cette démarche. Pour le reste, il s’agit d’expliquer aussi simplement que possible la complexité — c’est l’intérêt de l’histoire — de chaque événement ou phénomène. Et, si possible, de faire écho au présent.
En ce qui concerne la presse, se sent-on parfois trahi dans la retranscription de ses propos?
Je me suis libéré de ce type de problèmes en limitant les entretiens oraux à la radio. S’agissant de la presse écrite, je ne travaille qu’à partir de questions écrites auxquelles je réponds dans la même forme. Cela évite les malentendus, mais oblige les journalistes à préparer un peu le sujet au lieu de s’appuyer sur la célèbre «relance». En revanche, on demeure impuissant à l’égard des titres et autres exergues. Je me rappelle avoir passé une bonne heure à expliquer à mon interlocuteur qu’aucun historien n’accédait aux archives du FSB (ex-KGB) et de tomber le lendemain sur la une suivante : «Un historien suisse dans les archives du KGB»!
Les célébrations arrivent à leur terme. Etes-vous soulagé de voir le bout du tunnel?
Le plaisir de pouvoir réfléchir à de nouveaux sujets devrait me permettre de surmonter le baby blues commémoratif. Mais cela fut une belle expérience, en particulier s’agissant des expositions, un genre que j’avais peu pratiqué jusque-là.
Jean-François Fayet est professeur ordinaire au Domaine d’histoire contemporaine de l’Université de Fribourg. Les commémorations de la Révolution russe de 1917 l’ont amené à participer à deux colloques, six tables rondes, deux conférences, trois expositions, etc. Last but not least, il a été sollicité plus d’une dizaine de fois par les médias, en Suisse et en France.
Plus d’infos sur sur sa page.
- Le scandale de l’astragale! - 02.03.2026
- 19 ans d’écart, deux doctorats, une même passion - 27.02.2026
- Bernd Giese: maître des liaisons carbone, virtuose des liens humains - 23.02.2026