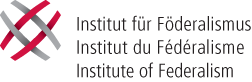publicationPublié le 11.06.2024
Trois publications dans le cadre du projet de recherche du FNS
Fin mai et début juin, trois contributions scientifiques ont été publiées dans le cadre du projet de recherche du FNS «La gestion des crises : Renforcer la démocratie, les droits de l'Homme et le fédéralisme» au sein des domaines de recherche – État de droit et démocratie, droits fondamentaux et droits de l'Homme et fédéralisme.
Dans le cadre du domaine de recherche «État de droit et démocratie», Luis A. Maiorini, dans sa contribution intitulée «Renforcement du Parlement en temps de crise – Appréciation de la révision de la LParl après la crise Covid-19», s'intéresse au renforcement du rôle du Parlement dans la perspective de crises futures. Après la présentation des modifications apportées à la loi fédérale sur l'Assemblée fédérale à la suite de la pandémie de Covid-19, il arrive à la conclusion que pour renforcer le rôle du Parlement en temps de crise, le développement des instruments parlementaires est à lui seul insuffisant. En effet, l'application de ces instruments dépend du consensus politique ainsi que des ressources disponibles. Il souligne en outre la pertinence des commissions et la nécessité de les consulter à temps. Seule la capacité d'action des commissions permet au Parlement d'établir lui-même un fonctionnement du Parlement efficace et de mettre en œuvre les instruments parlementaires. Enfin, l'auteur complète sa contribution par des explications appréciatives sur les adaptations de la loi fédérale du 18 mars 2005 relative à la procédure de consultation, sur les efforts de numérisation dans le cadre des sessions ainsi que sur la question des ressources, et synthétise ses conclusions dans un résumé enrichi de ses propres propositions de révision.
Dans la contribution «Contrôle judiciaire du droit d'urgence – Protection juridique efficace dans la gestion de crise» du champ de recherche «Droits fondamentaux et droits de l'Homme», Johanna Jean-Petit-Matile soumet le contrôle judiciaire du droit d'urgence à un examen critique. Elle se penche en particulier sur la pandémie Covid-19 et montre, sur la base des expériences faites à cette occasion, les lacunes de la protection juridique pendant les crises, identifie les défis correspondants et présente en même temps des propositions d'amélioration et d'adaptation de la protection judiciaire dans un État de droit résistant aux crises. Concrètement, elle analyse trois propositions d'extension de la juridiction constitutionnelle. La première proposition reprend différentes initiatives parlementaires qui proposent la possibilité de contester les ordonnances d'urgence du Conseil fédéral. L'analyse montre qu'une telle mesure permettrait globalement d'améliorer la protection juridique, mais que de nombreuses questions restent en suspens quant à son organisation concrète. Comme deuxième proposition, elle envisage une procédure d'urgence auprès du Tribunal fédéral en cas de recours à l'art. 185 al. 3 Cst. afin de contrebalancer la restriction de droits fondamentaux généralement importants dans le sens d'un contrôle judiciaire certes a posteriori, mais rapide. Enfin, elle souligne la possibilité, toujours très discutée, d'une juridiction constitutionnelle complète. En raison de la situation politique initiale, il ne faut toutefois pas s'attendre à ce qu'elle soit introduite dans un avenir proche. Dans l'ensemble, l'auteure regrette qu'aucune des propositions d'amélioration de la protection judiciaire n'ait été mise en œuvre jusqu'à présent.
Dans leur contribution «Systèmes cantonaux de droit d'urgence – Un aperçu comparatif du droit d'urgence intraconstitutionnel dans les cantons» du champ de recherche «Fédéralisme», Stefanie Rusch et Bernhard Waldmann passent en revue la diversité bigarrée des systèmes cantonaux du droit d’urgence. Dans le cadre d'une étude comparative, les auteurs analysent les clauses constitutionnelles du droit d'urgence et d'état d'urgence sur la base de la systématique, des conditions d'application, de l'étendue des compétences ainsi que des mécanismes de compensation démocratiques et de l'Etat de droit et tentent de mettre en évidence les points communs et les différences correspondantes – notamment dans le contexte de la pandémie Covid-19 et d'autres situations de crise. Dans une appréciation finale des normes cantonales, ils esquissent les éléments essentiels des systèmes de droit d'urgence qui permettent d'agir à la fois rapidement et avec suffisamment de légitimité dans des situations extraordinaires. Les auteurs soulignent tout d'abord que renoncer à un système de droit d'urgence au niveau cantonal est difficilement compatible avec l'Etat de droit et qu'il est indispensable pour des raisons de démocratie et de sécurité juridique. Outre l'ancrage obligatoire au niveau constitutionnel, il convient de clarifier le rapport entre les clauses de droit et d'état d'urgence et les éventuelles clauses d'habilitation prévues par des lois spéciales ainsi que la clause générale de police. Il faut certes se distancer d'une activité réglementaire trop étendue, mais l'étendue des compétences en matière de mesures ainsi que les correctifs démocratiques de l'Etat de droit doivent impérativement être ancrés dans les clauses relatives au droit et à l'état d'urgence. Au final, la plus grande difficulté serait de résoudre la tension entre une densité normative qui tienne compte des caractéristiques spécifiques d'une crise d'une part et la sécurité juridique requise d'autre part.