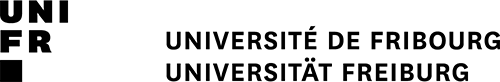Philosophie moderne et contemporaine (pmc)
La philosophie moderne et contemporaine recouvre une période que les historiens font généralement débuter au XVIIe siècle avec l’œuvre de Descartes et qui se poursuit jusqu’à nos jours. Extrêmement riche et diversifiée, elle se caractérise toutefois par quelques constantes telles qu’un retour à l’autonomie du discours philosophique après la période de la philosophie médiévale chrétienne ainsi que, dans le sillage de l’émergence de la science, un questionnement toujours plus profond du caractère proprement philosophique de certaines problématiques traditionnelles.
La philosophie moderne et contemporaine peut également être décrite sous l’angle des grandes écoles de pensée qui la caractérisent telles que le rationalisme classique, l’empirisme britannique, la philosophie transcendantale, l’idéalisme, la phénoménologie ou encore les différents courants de la philosophie dite "analytique". Dans chacune de ces écoles, des avancées philosophiques décisives ont été accomplies, et ceci dans tous les domaines de la philosophie, à l’image de l’épistémologie, de la philosophie de l’esprit, de la philosophie du langage ou encore de la philosophie politique et de l’éthique.
L’étude de la philosophie moderne et contemporaine comporte un intérêt double. Il s’agit, premièrement, de se familiariser avec les courants de pensée qui ont posé les fondations de notre culture contemporaine et, deuxièmement, de maitriser les outils conceptuels et méthodologiques qui permettent de participer au débat contemporain et ainsi de perpétuer le développement de la tradition philosophique occidentale.