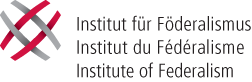Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et la démocratie
La Chaire UNESCO pour les droits de l’homme et la démocratie à l'Université de Fribourg analyse de façon interdisciplinaire les droits de l’homme, leur contenu, leur interdépendance et leur mise en œuvre, en se concentrant en particulier sur les droits culturels. Un deuxième thème central de la Chaire est la relation entre les droits de l’homme, la démocratie et le fédéralisme.
Ses activités sont réalisées en étroite collaboration avec le réseau mondial des Chaires UNESCO, l’Observatoire de la diversité et des droits culturels, l’Institut du Fédéralisme, l’Institut interdisciplinaire d'éthique et des droits de l'homme et de nombreux autres
-
Historique et mission
En 1998, une Chaire UNESCO pour les droits de l'homme et la démocratie a été créée à l'Université de Fribourg. Centrée depuis sa création sur les liens entre l'indivisibilité des droits de l'homme et les différentes formes de culture démocratique, elle vise de façon interdisciplinaire la spécificité de chaque droit qui compose le système des droits de l'homme autant et les liens d’interdépendance essentiels à leur interprétation comme à leur mise en œuvre.
Au sein de cette indivisibilité, l’étude fut spécifiquement centrée sur les droits culturels, en tant que « catégorie de droits de l'homme » encore très peu développée. « Une fonction importante de la chaire sera de développer la recherche et l'enseignement dans le domaine des droits culturels et de collaborer à l'élaboration des instruments dans ce domaine. » (Accord établissant la Chaire, §6)
L’universalité, l’indivisibilité et l’interdépendance des droits de l'homme sont les trois principes qui assurent l’objectivité des normes d’éthique politique fondamentale, car ils empêchent théoriquement les différents acteurs, étatiques ou non, de choisir les droits qui leur conviennent. La réalité est loin de cet idéal de démocratie partagée. La prise en compte de la diversité des cultures démocratiques dans une approche interdisciplinaire de l’éthique et des droits humains est le fil rouge de la Chaire.
La mission des chaires UNESCO consiste à développer la recherche, mais aussi l'enseignement, en lien avec le réseau mondial des Chaires UNESCO, selon le système de jumelage et de mise en réseaux des universités (programme UNITWIN).
-
Activités (sélection)
Depuis 2022 : Différentes démarches pour mettre à jour et complémenter la Déclaration de Fribourg.
2023 – 2025 : Projet de recherche financé par le FNS sur les droits de l'homme, la démocratie et le fédéralisme en temps de crise, analysant la gouvernance suisse de la pandémie COVID-19.
2022 – 2025 : Projet de recherche Horizon Europe, évaluant la gouvernance légitime des crises dans les systèmes multiniveaux (LEGITIMULT). Le projet analyse l'impact des mesures COVID-19 sur la gouvernance démocratique et les droits de l’homme en Europe.
2011 – 2022 : De nombreux projets réalisés en collaboration avec le Centre suisse de compétence pour les droits humains (CSDH), en particulier sur les droits de l’homme des personnes vulnérables.
2020 – 2021 : Projet et conférence sur les droits culturels des exilés, en collaboration avec la Chaire UNESCO sur la diversité des expressions culturelles de l’Université Laval à Québec.
2011 – 2018 : Projet pour observer les politiques publiques au regard des droits culturels (Paideia), en étroite collaboration avec Réseau Culture 21.
2016 : Projet de recherche sur la mise en œuvre politique de l’approche basée sur les droits de l’homme en développement, avec la Chaire UNESCO sur « Human Rights, International Cooperation and Sustainable Development » de l’Université de Bergame.
2013 – 2016 : Projet de recherche sur l’intersectionnalité dans les violations des droits humains et les discriminations multiples, soutenu par SNIS.
2009 : Collaboration avec le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme et le Comité des droits économiques, sociaux et culturels lors de la création d’une procédure spéciale dans le domaine des droits culturels, et contribution aux rapports de la rapporteuse spéciale dans le domaine des droits culturels.
2007 : Contribution internationale décisive de la Chaire au développement des droits culturels par la publication de la Déclaration des droits culturels, dite Déclaration de Fribourg.
2005 : Collaboration avec le Conseil de l'Europe à maintes reprises et notamment lors de l’élaboration de la Convention-cadre du Conseil de l'Europe sur la valeur du patrimoine culturel pour la société (dite Convention de Faro).
2001 : Collaboration avec l'UNESCO et l’Organisation internationale de la Francophonie lors de l’élaboration de la Déclaration universelle sur la diversité culturelle et son interprétation.
-
L’équipe
Le premier titulaire de la Chaire UNESCO a été le professeur de droit constitutionnel Marco Borghi, de 1998 à 2016.
Prof. Dr. Eva Maria Belser, professeure de droit constitutionnel et administratif, également co-directrice de l'Institut du Fédéralisme, lui a succédé en 2016.
Prof. Dr. Sarah Progin-Theuerkauf, professeure de droit européen et de droit des migrations, également co-directrice du Centre de droit des migrations, a rejoint la Chaire en 2020 en tant que co-titulaire.
La coordination de la Chaire est assurée par Dr Rekha Oleschak. Patrice Meyer-Bisch (MER) est l’ancien coordinateur et travaille toujours étroitement avec la Chaire. Il est le président de l’Observatoire de la diversité et des droits culturels.
- Partenaires